-
Par Tyron29 le 26 Avril 2011 à 14:17
LES ENVAHISSEURS SONT PARMI NOUS
CERTAINS COMMENCENT A LE PENSER SERIEUSEMENT…
Et si les extraterrestres vivaient déjà depuis plusieurs années parmi nous ? C’est le thème d’une série à succès en France et outre manche à l’époque : Les Envahisseurs (The Invaders). Dans cette histoire, à mi-chemin du feuilleton policier et de science-fiction, les extraterrestres avaient réussi à imiter l’aspect physique des hommes, à un léger détail anatomique près (le petit doigt relevé) et ils avaient décidé d’envahir notre terre en s’infiltrant, peu à peu, dans la population de notre globe.
Et bien cette histoire qui a pu paraître rocambolesque à certains, des savants sont, aujourd’hui, prêts de le croire tout à fait plausible. Jacques Bergier était de ceux-là. « A mon avis, disait-il, après la période de simple contrôle et d’enregistrements de ce qui s’est passé sur Terre, vint la période, commencée depuis quelques siècles, où les Intelligences décidèrent d’effectuer des expériences. Celles-ci consistent à introduire dans notre milieu des êtres susceptibles de provoquer les réactions les plus diverses et à étudier, ensuite, la façon dont nous nous comportons, comme on étudie le comportement des rats dans les labyrinthes artificiels ».
Et, en effet, on trouve, à différentes périodes de notre histoire, le récit de certains de ces êtres débarqués sur notre terre, venant de nulle part. L’un des plus célèbres est, évidemment, le comte de Saint-Germain que personne n’a jamais vu mourir et qui revient périodiquement au fil des siècles. Kaspar Hauser, « l’orphelin de l’Europe » dont on a fait le héros d’un film dans les années 80, est également un cas troublant. Cet adolescent apparut, un jour de mai 1828, à Nuremberg. Il avait une quinzaine d’années, mal habillé, il était incapable de parler et savait à peine marcher. Il avait bien deux lettres dans sa poche, mais les indications qu’elles donnaient se révélèrent totalement fausses et elles étaient faites d’une curieuse matière, ni papier, ni parchemin, mais plutôt une sorte de cuir ultra-mince. Kaspar Hauser ne savait pas d’où il venait. Il réussit à apprendre à parler, mais ne put rien révéler sur sa mystérieuse origine. Il fut assassiné, le 14 décembre 1833, dans un parc, par un inconnu qui lui avait donné rendez-vous, sous prétexte de lui révéler son identité. Kaspar Hauser n’était pas de ce monde, en ont conclu certains. Il provenait d’une autre planète, peut-être même d’un autre univers.
Au XVIIe siècle, en Angleterre, une jeune femme avait causé la même surprise. Elle était apparue, un jour d’avril 1817, dans le petit village d’Almondsbury, vêtue d’un sari et parlant une langue inconnue. Elle ne savait pas écrire et tout ce que l’on tira d’elle, avec force signes, fut qu’elle devait se nommer Carabo. On la recueillit, on lui apprit à parler et elle raconta qu’elle était princesse d’un pays lointain, mais qu’on ne parvint jamais à situer sur aucune carte. Plus tard elle se maria et déclara qu’elle avait menti, qu’elle était, en réalité, anglaise et s’appelait Mary Wilcox. Malheureusement toutes les démarches entreprises ne permirent jamais de retrouver une trace de cette femme. Et la princesse Carabo mourut, à l’âge de soixante-dix ans, en emportant dans la tombe le secret de sa mystérieuse origine. Au 19 ème siècle on découvrit, également, à Paris, un amnésique qui ignorait tout de son identité. On trouva dans sa poche la carte d’une planète qui n’était pas la terre. En 1954 on dut vérifier, à la suite d’émeutes, les passeports de tous les étrangers qui se trouvaient au Japon. Dans un hôtel la police découvrit ainsi un personnage qui possédait un passeport apparemment en règle. Il n’y avait ni grattage, ni surcharge, la photo d’identité était exacte, ainsi que les empreintes digitales. Mais le passeport en langue arabe, était délivré par un pays qui n’existait pas : le Tuared. On interrogea l’homme qui expliqua que le Tuared se trouvait entre la Mauritanie et le Soudan. On consulta des cartes anciennes, on s’enquit auprès des Nations Unies. Personne, jamais, n’avait entendu parler de ce pays. Finalement, le ressortissant du Tuared fut enfermé dans un asile psychiatrique. Pourtant son comportement était parfaitement normal.

Mais, parfois, on va encore plus loin dans l’étrange quand les êtres venus d’ailleurs ne sont pas tout à fait comme nous. En août 1887, près du village de Banjos, en Espagne, des paysans virent, tout à coup, sortir d’une cave deux enfants, un garçon et une fille, visiblement perdus et apeurés. On s’empressa à leur rencontre. Ils étaient habillés de vêtements dont le tissu ne ressemblait à aucune matière connue et, surtout, leur peau avait une couleur étrange : verte. Verte comme les feuilles ou l’herbe des champs. Leurs traits étaient un peu de type négroïde, mais leurs yeux en amande, étaient plus proches des Asiatiques. On essaya de les faire manger, mais ils refusèrent tout, sauf des haricots fraîchement cueillis qu’ils dévorèrent crus. Des spécialistes vinrent de Madrid étudier les deux étranges enfants que l’on avait placés chez le juge. Mais ils essayèrent en vain d’identifier la langue qu’ils parlaient, comme le tissu dont leurs vêtements étaient faits. Le petit garçon qui paraissait le plus faible mourut, quelques jours plus tard. La petite fille, elle, survécut quelques années. Assez pour apprendre un peu d’espagnol et donner une description du pays d’où elle venait. Description des plus étonnantes puisqu’elle décrivit son pays comme une région sans soleil où régnait, en permanence, une sorte de crépuscule. Ce pays était séparé, par une large rivière, d’un pays voisin, au contraire très lumineux. La petite fille ne put pas réellement expliquer comment elle avait débarqué sur terre. Elle parla d’un bruit terrible et d’un grand tourbillon.
En 1948 on a encore retrouvé en Australie – pays où les observations de soucoupes volantes sont particulièrement nombreuses – un cadavre d’un être étrange dans une mine de cuivre désaffectée. Ses yeux étaient dépourvus de cils, il avait des lèvres minces, un nez fort et légèrement épaté, des oreilles très pointues. Dans ses poches on retrouva un mystérieux message codé que personne n’a jamais réussi à déchiffrer. Georges Langelaan, de son côté, rapporte quelques cas particulièrement déroutants.
« J’ai pour ma part, connaissance d’un fait très troublant qui s’est déroulé en Angleterre, dans les années soixante. Un jeune homme accidenté avait été conduit à l’hôpital. Là on lui fit un prélèvement sanguin, on le pansa, puis on le laissa repartir car sa blessure était bénigne. Mais quelle ne fut pas la surprise des médecins de constater, en analysant son sang, qu’il n’appartenait à aucun groupe connu sur terre. En particulier les globules avaient une curieuse forme ovale. On chercha à retrouver le mystérieux jeune homme, mais on n’y parvint pas, car il avait donné un faux nom et une fausse adresse. Je pense qu’il s’agissait d’un extraterrestre ».
Aux Etats-Unis on a également découvert certains hommes, morts accidentellement, qui avaient deux cœurs. Et, en 1959, on retrouva, sur la plage de Dantzig, un curieux cadavre. Quand on l’autopsia on s’aperçut qu’il avait une circulation horizontale et non verticale, comme tous les êtres humains vivant sur terre. Le mystérieux cadavre fut transporté dans un hôpital de Moscou, mais, depuis, plus personne n’en a entendu parler. Tous ces faits ont de quoi troubler ou inquiéter. Car ils prouveraient, en effet, que les extraterrestres n’en sont plus seulement à nous surveiller de leur soucoupe, ou même à atterrir pour une rapide exploration. Ils ont déjà débarqué. Ils sont là, parmi nous, sans que nous le sachions. Ce sont peut-être nos voisins de palier ou nos collègues de bureau. D’autres spécialistes avancent des hypothèses encore plus hardies. Les voyageurs de l’espace ne sont pas, comme nous, soumis à la loi inexorable du temps, ils se perpétuent sur des centaines et des milliers d’années. Aussi réussissent-ils, sur terre, à s’incarner dans des enveloppes terrestres dont ils annihilent l’âme et l’esprit pour prendre sa place. Et ils en changent quand la mort a fait son œuvre.
Ainsi, peut-être allons-nous devenir, peu à peu, des extraterrestres sans le savoir !
*
Nostra n°202 de février 1976- juin 2009
 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Tyron29 le 1 Mars 2011 à 11:35
A la fin du XIX° siècle, à Santa-Fé (Nouveau Mexique, Etats-Unis), un mystérieux charpentier réalise un escalier à la tenue inexplicable. Parmi les miracles reconnus, ceux qui sont attribués à Saint Joseph sont rares. L’Escalier de Santa Fé, malgré la prudence des uns et l’hostilité des autres, est pourtant toujours debout : inexplicable, étonnant, magnifique. Il continue de susciter, selon les sensibilités, l’admiration ou le doute dont la controverse s’alimente.
Des soeurs catholiques s'installent au Nouveau Mexique
Voici plus d’une centaine d’années, en septembre 1852 pour être tout à fait exact, les Sœurs de Lorette vinrent dans le sud ouest des Etats-Unis, voyageant en fourgon bâché et en bateau à aubes. Leur voyage avait débuté au mois de mai précédent, dans le Kentucky, sur un vapeur baptisé le « Lady Franklin », qui leur fit remonter le Mississipi jusqu’à Saint Louis ; de Saint Louis à Independance (Missouri), elles prirent le « Kansas » : mais en trajet, un grand malheur fondit sur la petite communauté. La Supérieure, Mère Mathilde, fut terrassée par le choléra et mourut peu après leur arrivée à Independance. Deux autres des Sœurs contractèrent aussi la maladie, mais en guérirent.
Après plusieurs autres mois de difficultés et de frayeurs, d’essieux et de roues cassés, de journées torrides et d’os blanchis entrevus, ce qui restait du groupe finit par arriver à Santa Fe, Nouveau Mexique. Les Sœurs Madeleine, Catherine, Hilaire et Roberte fondèrent la communauté. À la requête de Monseigneur Lamy, Sœur Madeleine fut désignée comme supérieure du groupe par la maison mère. C’était une femme résolue, fervente, et la situation à laquelle elle dut faire face avec ses Sœurs était une situation difficile.
Ces sœurs de Lorette étaient de grandes dames, parfaitement pénétrées de l’amour de Dieu, et c’est uniquement cela qui leur permit d’affronter les épreuves de ces premières années. La contrée étant encore rude et mal installée, il n’y avait pas, à leur arrivée, de couvent confortable qui les attendait. À cette époque, la ville de Santa Fe était habitée principalement par des indiens et par des mexicains. Elles vécurent tout d’abord, dans une petite maison d’une seule pièce en briques brutes. Santa Fe est désormais une ville de bonne taille, bien qu’avec ses rues étroites et pittoresques, elle conserve vivante l’ancienne atmosphère du vieux Santa Fe. La construction de la chapelle
Mais revenons en 1852 : il devint rapidement évident que si les sœurs voulaient répondre aux intentions de Monseigneur Lamy, qui souhaitait en les amenant à Santa Fe, qu’elles instruisent les gens, qu’elles auraient besoin d’un couvent et d’une chapelle. Les charpentiers mexicains commencèrent à travailler pour les Sœurs. L’école fut terminée, et on l’appela le Collège de Lorette, de Notre Dame de Lumière. Des plans en vue de la construction d’une magnifique chapelle furent ensuite élaborés. Selon les annales des Sœurs pour cette année-là, la chapelle fut commencée le 25 juillet 1873. C’est le même architecte qui avait dessiné la cathédrale de Santa Fe, M Mouly, qui en fit les plans. Monseigneur Lamy venait de France, et il avait voulu que les Sœurs aient une chapelle similaire à la Sainte Chapelle de Paris, qu’il affectionnait particulièrement. Cela signifie qu’elle devrait être strictement gothique, et de fait, elle sera la première structure gothique à l’ouest du Mississipi.
Les constructeurs mexicains se remirent à travailler sur la nouvelle bâtisse. Elle serait grande ; plus grande en fait que la plupart les chapelles des missions de cette contrée. Elle devait faire 25 pieds de large (8 mètres environ) 75 pieds de long (23 mètres environ) et 85 pieds de haut (26 mètres environ). Sœur Madeleine note dans les annales que la construction de la chapelle était placée sous le patronage de Saint Joseph, « en l’honneur duquel nous recevions chaque mercredi la Sainte Communion afin qu’il nous prête assistance ». Puis elle ajoute : « nous avons été témoins de la puissance de son aide en plusieurs occasions ».
Les travaux de construction de la chapelle se réalisèrent non sans quelques difficultés financières, et de la part des Sœurs, avec un maximum de Foi. Ce n’est que lorsqu’elle fut presque terminée qu’elles se rendirent compte qu’une horrible erreur avait été faite. La chapelle en elle-même était magnifique : et la tribune pour la chorale ne l’était pas moins. Mais aucune liaison entre les deux n’avait été prévue ! Il n’y avait pas de cage d’escalier, et l’exceptionnelle hauteur de la tribune ne laissait pas la place d’en positionner un ordinaire. Mère Madeleine fit appel à de nombreux charpentiers pour essayer de construire un escalier : mais les uns après les autres, ils prenaient les mesures, réfléchissaient, puis ils hochaient la tête en disant tristement : « c’est infaisable, ma Mère ». Il semblait n’y avoir de choix qu’entre deux solutions : mettre une échelle pour atteindre le chœur, ce qui paraissait dans tous les cas peu pratique, ou raser tout l’édifice, pour le reconstruire différemment. La dernière solution eût été un crève-cœur.t
Pourtant, quiconque connaît les Sœurs, quelles qu’elles soient, sait qu’elles ne se résoudront pas à des solutions aussi drastiques sans d’abord avoir dit quelque chose comme « attendons un peu, et faisons une neuvaine ». Et parce qu’elles avaient une grande dévotion à Saint Joseph, les Sœurs de Lorette lui adressèrent une neuvaine, afin qu’il trouve une solution convenable à la question. Le dernier jour de la neuvaine, un homme aux cheveux gris se présenta au couvent, avec son âne et sa caisse à outils. Lorsqu’il vit Mère Madeleine, il lui demanda s’il pourrait aider les Sœurs à construire un escalier ! La Mère donna volontiers son accord, et il se mit au travail. Selon la tradition orale, passée par les sœurs présentes à l’époque aux suivantes, les seuls outils en sa possession étaient un marteau, une scie et une équerre en té. Il mit entre six et huit mois pour terminer le travail. Lorsque Mère Madeleine chercha à le payer, il avait disparu. Elle se rendit alors à la scierie locale pour payer au moins le bois utilisé. Là, personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Il n’y a, à ce jour, aucune trace, aucun document établissant que ce travail n’ait jamais été payé. aordinaire escalier
L’escalier en colimaçon laissé par le vieil homme aux Sœurs est un chef d’œuvre, aussi magnifique qu’étonnant. Il fait deux tours complets (2 x 360°) sur lui-même. C'est un escalier colimaçon à noyau creux, il n’y a aucun pilier pour le soutenir, comme la plupart des escaliers circulaires en ont. Cela signifie qu’il est suspendu sans aucun support. Tout son poids repose sur sa première marche. Plusieurs architectes ont avancé qu’il aurait dû s’effondrer sur le sol au moment même où la moindre personne se serait aventurée sur la première marche : et il a cependant été utilisé quotidiennement pendant plus de cent ans. L’escalier a été assemblé exclusivement par des chevilles en bois : il n’y a pas un seul clou. La partie située sous les marches et entre le limon et la crémaillère ressemble maintenant à du bois léger : c’est en réalité du plâtre mélangé à du crin de cheval destiné à donner de la rigidité. Trop nombreux sont les visiteurs à avoir succombé à la tentation de rapporter chez eux un souvenir, et d’avoir pour cela arraché à l’escalier des morceaux de plâtre. En 1952, lorsque les sœurs ont fêté le centenaire de leur arrivée à Santa Fe, elles ont remplacé le plâtre, et l’ont peint de manière à lui donner l’aspect du bois vernis.
A Al’époque de sa construction, l’escalier n’avait pas de rampes. Elles furent ajoutées quatre ou cinq ans plus tard. L’une des jeunes filles qui se trouvaient alors dans ce collège, avait à l’époque environ treize ans. Elle devint plus tard Sœur Marie, dans cette congrégation des Sœurs de Lorette, et ne se fatiguait jamais de raconter comment elle et ses amies furent parmi les premières à grimper à cet escalier. Elle disait aussi qu’elles avaient tellement peur de monter à la tribune, qu’elles en redescendaient sur les mains et sur les genoux.
L’actuelle Supérieure de la communauté Sœur Januarius, m’a dit que des visiteurs sont venus du monde entier voir cet escalier merveilleux. Parmi eux, de nombreux architectes qui, sans exception, lui ont dit qu’ils ne comprenaient pas comment l’escalier avait été construit, ni comment il demeurait en aussi bon état après quasiment un siècle d’utilisation.
*
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Tyron29 le 1 Janvier 2011 à 17:53
LES EX-VOTO
CES MYSTERIEUSES OFFRANDES DES HOMMES AUX DIEUX
Marques de remerciements, cadeaux propitiatoires, silhouettes rêvées du personnage que l’on voudrait bien devenir un jour : les ex-voto sont un peu tout cela à la fois. Ils nous apprennent plus sur une époque que bien des documents…

Depuis les plus anciens jours de l’Histoire humaine, on trouve des ex-voto. Offerts dans les temples, ces objets devaient séduire assez les dieux pour inciter ceux-ci à se montrer généreux. Les Grecs, et bien avant eux : les Crétois et les Sumériens éprouvaient le besoin de faire offrande à leurs dieux. Ces offrandes étaient parfois extrêmement chères au cœur de ceux qui offraient. On sait que des pères sacrifièrent ainsi leurs propres enfants, que des mères tendirent éplorées leurs bébés au grand sacrificateur qui veillait à fournir son lot de suppliciés au dieu jamais repu de vies humaines. A Carthage brûlait presque sans cesse le fourneau horrible du dieu Baal. Et dans les sources de la Seine, les Gaulois des forêts d’alentour venaient déposer des statues de bois que l’on découvre aujourd’hui, sous un linceul de sédiments. Généralement les ex-voto étaient des objets précieux, auxquels on tenait, soit en tant qu’outils indispensables et rares, soit en tant que bijoux personnels. Curieusement, on constate que les ex-voto ne sont réclamés par aucune religion monothéiste. Le don d’ex-voto est un geste spontané que l’on tolère dans les temples des grands cultes monothéistes. C’est un acte de foi sympathique, sans plus. Un acte de foi presque toujours émouvant parfois poignant.
Comme les êtres humains, les ex-voto sont inégalement riches et beaux. Parfois de véritables œuvres d’art ont été crées spécialement pour appeler l’attention de Dieu, ou pour le remercier d’avoir été très généreux. La fonction spirituelle des ex-voto est évidente, même quand ce sont des objets usuels qui sont offerts. Les béquilles de Lourdes ne sont-elles pas aussi précieuses à Dieu que les plus beaux tableaux de tel grand maître offerts en ex-voto ? Lorsque l’ex-voto est offert comme une prière demandant à Dieu de se mêler particulièrement de tel ou tel malheur humain, il prend valeur de requête humblement exprimée. Les ex-voto ne sont que rarement signés. L’ex-voto de remerciement a peut-être moins de prix que l’autre. Il sanctionne un état de fait acquis. Le plus ancien ex-voto de France remonte à 1591 ; il se trouve dans l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer. Mais plusieurs tableaux votifs d’Allemagne semblent plus anciens encore, remontant sans doute au tout début du 16e siècle. Les ex-voto apparaissent dans les églises européennes, par vagues, comme si leur abondance avait quelque chose à voir avec les périodes de tourments, d’inquiétudes de particulière acuité. Il est étonnant de constater que le tempérament des peuples se traduit dans la gamme des ex-voto qui sont visibles dans ses églises. Les Allemands ont de tout temps préféré les tableaux représentant des scènes bucoliques, forestières, dans une ambiance de flou et de mystère.
Les Français excellent dans la fabrication des ex-voto artisanaux, qui représentent des outils de travail. Les Italiens offrent des ex-voto bien soignés, de véritables bijoux. Au Japon, c’est l’image peinte du cheval qui est le plus souvent offerte en ex-voto. Cette image est peinte sur des panneaux de bois ; elle a pris la place des chevaux en chair et en os que l’on logeait jadis dans les temples consacrés aux dieux. L’ex-voto japonais d’autrefois coûtait vraiment très cher. D’où nous viennent les ex-voto « anatomiques » : les pieds, les mains, les bras qui se voient dans de nombreuses églises ? Ce n’est pas la religion chrétienne qui a fait naître ces ex-voto, car ceux-ci figuraient auparavant dans les cultures païennes. Il est des dieux et des déesses qui ont été tout spécialement honorés par des profusions d’ex-voto. Ce fut le cas de la déesse Sequana qu’honoraient les Gaulois et les Romains, et dont le temple naturel était tout simplement la source de la Seine. Les ex-voto des sources de la Seine portent souvent la signature d’une maladie : chassie des yeux, goitre, cancer. C’est donc la preuve que, dès ce temps-là, l’ex-voto était offert à la puissance supérieure, dans l’intention de lui demander une intervention précise. Quels sont les plus grands pourvoyeurs d’ex-voto ?
Incontestablement ce sont les peuples qui vivent dangereusement, donc les peuples de marins, de pêcheurs, de soldats. Pour cette raison, les églises, les temples, les mosquées et les synagogues des régions littorales sont généralement riches en ex-voto de grand prix. Les bateaux des grandes expéditions comportaient un coin destiné aux ex-voto. Par la suite, on garda l’habitude de se faire accompagner de ses propres ex-voto, à bord des navires de guerre, et même à bord des avions de bombardement. Peu à peu d’ailleurs, cette coutume a dégénérée, et l’ex-voto a quelque peu perdu son caractère d’objet de piété et de foi, pour devenir une sorte de gri-gri, de talisman : le bas de femme pour les aviateurs par exemple. L’ex-voto est au fond le paraphe d’une civilisation qui manifeste ainsi, pour les siècles des siècles, sa ferveur, sa reconnaissance, et son désir de rendre témoignage, à la face du monde. En ce sens donc, il est un acte de culture hautement significatif qui nous en apprend plus sur telle ou telle époque de l’Histoire humaine que de nombreux documents d’archives. C’est ainsi que les ex-voto des marins de Christophe Colomb, représentant des épouses et des mères, nous font sentir ce que fut le désarroi de ces hommes de leur environnement féminin. Et les pieds lépreux du Moyen-Âge nous disent combien cette maladie fut alors redoutée.
Dans le tableau reconstituant un accident de voiture, qui nous montre un lourd chariot tiré par deux chevaux, et qui roule sur le corps d’un jeune homme, l’œil découvre tous les détails d’une existence quotidienne du siècle dernier.

Source- recherches personnelles/mai 2009
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Tyron29 le 14 Octobre 2010 à 19:05
LE MYSTERE DU CHEMIN DES ETOILES

Au milieu du XXe siècle, dans nos campagnes de France, on entend fréquemment encore évoquer la Voie Lactée sous le nom de Chemin de Saint-Jacques. Cette appellation n’est pas gratuite : depuis près de deux millénaires, les hommes ont remarqué la correspondance qui existe entre la route antique qui, au sol, court des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle et notre galaxie, la Voie Lactée, qui en indique la direction dans le ciel.
En fait, Saint-Jacques et les étoiles, au fil des siècles, mélangent leurs images comme si le christianisme, en poussant par centaines de milliers les pèlerins de l’Europe tout entière sur cette chaussée vénérable, avait fait en sorte de récupérer avec un succès éclatant du reste, le mouvement qui bien auparavant, sur ce chemin marqué par les étoiles, conduisait déjà les initiés, dans leur marche irrésistible vers l’Ouest, jusqu’aux limites extrêmes du grand océan.
Fils de Zébédée et de Marie-Salomé et frère de saint Jean l’Evangéliste, Jacques le Majeur était l’un des trois élus parmi les douze apôtres que Jésus surnomma Boanergès c’est-à-dire Fils du Tonnerre, probablement à cause d’un tempérament aussi résolu qu’impétueux. Porté par sa fougue et son enthousiasme, il aurait bientôt traversé les mers pour venir évangéliser l’Espagne et c’est à Iria Flavia, maintenant Padron, à l’embouchure de la rivière Ulla et dans la région même où se trouve le cap qui constituait alors le bout du monde qu’il finit par aborder. Pendant sept années, il parcourt la péninsule ibérique sans rencontrer grand succès auprès des païens (seul un chien fut sensible à sa bonne parole) avant de retourner à Jérusalem où en l’an 44, le huitième jour des calendes d’avril, Hérode Agrippa le fait périr par le glaive. Après son martyre, ses compagnons, par crainte des juifs, furent contraints de quitter la Palestine, emmenant sa dépouille sur une barque sans gouvernail qui devait pourtant les conduire sur les rivages de Galice, dans le royaume d’une méchante reine nommée Louve et à l’endroit même où l’Apôtre avait accosté quelques années plus tôt. En dépit des intrigues et vilains travers de la terrible souveraine et à son grand étonnement, le sarcophage de l’Apôtre confié à la fantaisie d’un char attelé de taureaux indomptés, vint s’arrêter à cinq lieues de la mer, dans la cour de son propre palais. Dans ces conditions, elle ne pouvait faire autrement que de dédier celui-ci à saint Jacques et de faire édifier un mausolée en un lieu connu plus tard sous le nom d’Arcae Marmoricae parce qu’on y construisit en l’honneur du saint une série impressionnante d’arcs de marbre. Et puis, pendant plus de sept cents années, avec le déferlement des hordes barbares et plus tard des Arabes sur toute l’Espagne, le silence et l’oubli s’étendirent sur la tombe de Jacques le Majeur.
Jusqu’au jour où un ermite appelé Pélage (son nom prouve que c’était un homme de la mer) et quelques bergers dont on disait d’ailleurs qu’ils savaient communiquer avec les astres retrouvent le sarcophage, enfoui sous les broussailles, grâce à la présence d’une étoile qui brillait chaque nuit au-dessus d’un plateau désert. En souvenir de cette lueur céleste, ce lieu sauvage et désolé se voit attribuer le toponyme de Compostelle ce qui, selon l’étymologie populaire et en dépit des dénégations des philologues, indique qu’il s’agit du Campus Stellae ou Champ de l’Etoile. Il est d’autres explications comme celle du compost des alchimistes dont l’Etoile apparaissait à la surface du creuset au cours des premières phases de la réalisation du grand œuvre (n’oublions pas Maître Nicolas Flamel installé sous les piliers de l’église Saint-Jacques-la-Boucherie et le récit initiatique de son voyage en Galice, sur la tombe de l’Apôtre). Ou bien la formule qui rattache les deux éléments du nom à la collision ancienne d’un astre avec notre planète. Ou encore, secrète et plus dogmatique en même temps, l’idée selon laquelle on aurait voulu évoquer la présence du Maître de l’Etoile qui pourrait être saint Jacques mais qui pourrait aussi bien s’identifier au chef de ces énigmatiques compagnons surgis par delà l’océan « des bords mystérieux du monde occidental ». Enfin et traditionnellement, il y aurait une effective correspondance entre Compostelle, le chemin de l’Ouest et le Champ des Etoiles, cette Voie Lactée qui, dans notre ciel, est comme la route qui mène à la constellation du Grand Chien. En tout cas, très vite, le saint à l’Etoile acquiert une merveilleuse réputation et déjà les premiers pèlerinages commencent à s’organiser.
En 844, à la bataille de Clavijo, près de Logrono, Ramire II, à la tête d’une poignée d’Espagnols, livre aux Maures un combat difficile sinon désespéré. Soudain apparaît dans les nuées, au-dessus des troupes qui s’affrontent, un guerrier casqué et masqué dont la cuirasse est si brillante qu’elle resplendit au soleil à peu près comme la moderne combinaison d’un homme de l’espace. Sous son cimier lumineux, il brandit une arme qui flamboie et pour les chrétiens il ne fait pas de doute que ce cavalier du ciel survenu à point nommé pour galvaniser leurs énergies et les conduire à la victoire est évidemment Jacques le Matamore, c’est-à-dire le massacreur des Maures. Et c’est ainsi que saint Jacques accède au titre de Patron de l’Espagne, que Santiago devient le cri de guerre et de ralliement des Espagnols et que commence la reconquête… Il n’en reste pas moins que tout au long des chemins qui mènent à Compostelle, plantés tels des jalons « comme les cailloux semés par le Petit Poucet » s’égrènent montagnes, ruisseaux, villes, villages ou lieux-dits dont les dénominations évoquent curieusement le monde des étoiles. En France déjà, sur le chemin qui venait de Trèves par Vézelay et Périgueux, il existe dans les Pyrénées-Atlantiques, à quelques kilomètres au sud-ouest d’Orthez, un petit village appelé l’Hôpital d’Orion. Dès le début du XIIe siècle, il y avait là un hospice destiné aux pèlerins qui se rendaient en Galice mais, bien avant cette époque, le lieu portait le nom d’Orion comme cette constellation qui fait partie de notre galaxie. Une petite église construite au siècle suivant dans un style où le roman se mêle heureusement au gothique se dresse toujours dans ce calme vallon. Sur les modillons de la corniche, on remarque notamment une francisque sur un fond d’étoiles. Plus au sud, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et le col de Roncevaux, c’est-à-dire à proximité de la portion du chemin issue de la réunion des trois principales voies françaises, Orion est aussi le nom d’un torrent qui est un affluent de la Nive et d’une forêt dont les frondaisons trouvent place dans la mythologie des Basques. Entre Saint-Palais et Ostabat, là où convergeaient justement ces trois voies, il y a au flanc de la montagne un monument : c’est une stèle archaïque où se retrouve la double animation du voyage vers Compostelle puisqu’elle porte très symboliquement en son centre une croix inscrite dans une étoile à cinq branches. Au bord de la route venant du sud de la France, un autre gîte d’étape, l’Hôpital-Saint-Blaise, possède à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Pau, une église unique en son genre : ses arcs dessinent, à la croisée du transept, une étoile parfaite dont les nervures ménagent, selon la haute tradition des constructeurs du Moyen Age, un espace vide, le fameux oculus magique. Dans les murs, les ouvertures ne sont pas fermées par des vitraux mais par des sortes de claustra de pierre dont l’un au moins reproduit encore le dessin d’une étoile.
Dans tout le Pays Basque, on retrouve dans les noms de lieux le radical Lizarra (ou ses dérivés) ce qui bien entendu, dans la langue du pays se rapporte toujours à l’étoile. Que penser ainsi de Mauléon-Licharre, au sud de Sauveterre-de-Béarn, qui dispose de part et d’autre du Saison ses coquettes maisons et dont la deuxième partie de l’intitulé pourrait être la déformation du basque Lizarra ? Passant la frontière par le col d’Ibaneta, plus connu probablement sous l’appellation de col de Roncevaux, on trouve en descendant vers Burguete une très vieille croix en pierre rongée par le temps et les intempéries dite croix des Pèlerins. En sa partie haute, ce monument porte de façon encore très apparente, l’image d’une étoile à douze pointes dans laquelle certains spécialistes ont voulu reconnaître le dieu-soleil des Basques. Et l’on arrive en Navarre, dans cette Navarre dont Pampelune est la capitale et qui perpétue également dans la pierre et le métal, dans ses armes et blasons le souvenir des étoiles. Dans la région de Pampelune, un lieu-dit se dénomme Lizarraga ce qui veut dire à peu près poussière d’étoiles. Au nord-ouest de cette zone, deux cols portent respectivement les noms de Lizarraga (encore une fois…) et de Lizarrusti. Plus loin encore, en allant vers l’ouest, il y a des Izarra, un Astray qui fait naturellement penser aux astres et même en Galice, un Aster et puis, de l’autre côté des monts du Léon, il y a Liciella. Mais surtout, à près de cinquante kilomètres au sud-ouest de Pampelune, il y a Estella, la ville de l’Etoile surnommée aussi Estella-la-Bella par les pèlerins de Compostelle ou Jacquets en vénérant au passage la Vierge du Puy dont le moderne sanctuaire se dresse actuellement à l’emplacement même où en l’an 1085, des bergers informés par une pluie d’étoiles, découvrirent en creusant le sol, la statue entièrement recouverte d’argent. Toujours dans le même alignement général, c’est-à-dire dans cette zone orientée d’est en ouest comme la projection au niveau du sol de la voie céleste, voici la ville de Léon et les magnifiques vitraux de sa cathédrale qui montrent un pèlerin de Saint-Jacques muni d’une étoile et non pas de la fameuse coquille dont l’origine est apparemment beaucoup plus récente.
Tout ceci et bien d’autres exemples encore permettent d’affirmer la réalité d’un véritable Chemin des Etoiles dont la largeur pourrait atteindre environ cinquante kilomètres, étalé d’est en ouest sur le Roussillon et la zone nord de l’Espagne, depuis Perpignan jusqu’à l’océan Atlantique, entre le cap Finistère et l’île de la Toja. De toute évidence, le tracé de cet axe est bien antérieur à notre ère, mais le souvenir de ce Chemin des Etoiles s’était maintenu avec tant de force sourde dans la conscience collective des foules européenne (sans même parler des initiés qui ne l’avaient jamais oublié, ni abandonné) que le christianisme a pu considérer comme « rentable » de reprendre à son compte cette tradition de la marche vers l’Ouest, vers le soleil couchant qui avait gardé après tant et tant de siècles d’aussi puissantes et profondes racines. C’est ainsi qu’on est amené à l’idée que seuls des êtres exceptionnels et connaissant en tout cas bien mieux que les hommes du Moyen Age l’astronomie, la géographie et leurs techniques d’application ont été en mesure de jalonner ainsi un axe de 1500 km de longueur. Et cet axe avait bien sûr une signification et une utilité comme le confirme la force de cette tradition qui exigeait l’emploi de cette route et qui s’est perpétuée bien au-delà même des grands pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle. On se demande alors d’où arrivaient ces voyageurs aux pouvoirs extraordinaires qui, d’après certaines chroniques ou relations des pèlerins, suivaient à contresens c’est-à-dire d’ouest en est le Chemin de Saint-Jacques et n’avaient pas été remarqués par leurs compagnons au cours du trajet aller. Peut-être venaient-ils de la mer et étaient-ils, par exemple, les héritiers d’une civilisation supérieure telle que celle des Atlantes. En tout cas, décrits comme une cuirasse souple et d’une blancheur éblouissante, leurs vêtements pouvaient être en fait une combinaison étanche destinée à la vie marine.
Il y a quelques dizaines d’années, on pouvait voir encore, sur la côte de Galice, une très vieille chaussée de pierre qui s’enfonçait en pente douce dans la mer… De tout temps, on disait que c’était le chemin des géants, de ces mêmes géants, débonnaires et dangereux à la fois mais surtout incompréhensibles pour les humains que l’on rencontre dans les contes et les légendes qui fleurissent d’un bout à l’autre du Chemin de Saint-Jacques. On raconte qu’Hercule, après avoir été dérobé le troupeau de bœufs du géant Géryon, débarqua avec les bêtes en Galice et construisit ensuite à côté de La Corogne un phare qui fonctionne d’ailleurs toujours (du moins dans les années soixante-dix) et est connu sous le nom de Tour d’Hercule. A l’autre bout du chemin, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, on aperçoit dans la montagne, sur la frontière, à 1404 m d’altitude une tour circulaire d’environ vingt mètres de diamètre répertoriée sur les cartes sous le nom de redoute d’Urculu. Les quelques investigations faites dans les années 70 autour de cette construction qui font penser aux « nuraghi » de Sardaigne font croire que son origine pourrait se situer aux âges mégalithiques. En tout cas, Urculu est un nom qui se justifie mal en langue basque et c’est invinciblement qu’on évoque là aussi Hercule et l’éventualité d’un très ancien culte pyrénéen au demi-dieu grec. Ce pourrait être alors une plate-forme qui aurait permis aux gens venus du ciel et non pas de la mer de descendre sur terre pour accomplir telle ou telle mission dont les hommes garderont religieusement le souvenir dans leurs mythologies respectives. La première destination du Chemin des Etoiles était-elle religieuse et de même essence que celle que lui donne aujourd’hui le christianisme ?
On peut le croire sans écarter pourtant, pour des êtres venus d’ailleurs, l’hypothèse qui fait de cette voie où se brassaient les idées et les hommes un moyen de connaissance et de communication avec les Terriens. La question reste posée mais comme le disait un chroniqueur de haute époque, on croisait sur cette route des géants et des gens étranges qui n’étaient pas des Sarrazins et qui portaient des habits de lumière.
MAIS QUI ETAIENT-ILS DONC ?
 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Tyron29 le 2 Octobre 2010 à 11:35
MAIS OU SONT LES FUNERAILLES D’ANTAN ?
LE DEUIL N’A PAS TOUJOURS ETE UNE CHOSE SIMPLE
A la Toussaint, chaque année, comme chaque automne, les chrysanthèmes refleurissent les tombes dans les cimetières et les familles viennent s’incliner sur la dernière demeure de leurs défunts. Cette cérémonie traditionnelle est, aujourd’hui, une des dernières marques que nous réservons aux disparus.

La mort, en effet, semble de plus en plus faire peur aux humains, au point qu’on l’ignore le plus possible et que les morts s’en vont vers leurs dernières demeures dans l’affliction de quelques-uns, peut être, mais dans l’indifférence de la majorité. Et surtout, en faisant le moins de bruit possible et dans la discrétion la plus totale. Ce ne fut pas toujours le cas, loin de là. Et jusqu’à il n’y a encore guère longtemps, les morts quittaient notre vallée de larmes dans un grand renfort de pleurs, de cris et de marques ostensibles de chagrin. Mais ces manifestations de deuil ont énormément varié au cours des siècles, et suivant les civilisations.
Dans les peuplades primitives, la mort d’un chef était souvent accompagnée de mises à mort ou de mutilations d’autres membres de la tribu, comme pour accompagner le mort dans l’au-delà. Aux Îles Sandwitch, on continua, pendant longtemps, à arracher une dent à tous ses sujets quand le grand chef mourait et on sait qu’il n’y a pas si longtemps, on immolait encore sur le bûcher les veuves des grands maharadjahs aux Indes, en même temps qu’on incinérait le corps de leurs marins. Heureusement, ces marques extrêmes étaient rares. On se contentait, souvent, de sacrifices moins spectaculaires, comme chez les Hébreux qui déchiraient complètement leurs vêtements et se couvraient la tête de cendre. Chez les Egyptiens, on préférait se raser les sourcils et se couvrir la tête de terre et de boue. Les Grecs, eux, se coupaient la barbe et les cheveux, tandis que les Romains, en revanche, laissaient pousser l’une et les autres pendant tout le temps du deuil. Les Perses aussi se rasaient entièrement et tondaient, dans le même temps, tous les animaux de leur maison. A Délos, également, on se coupait les cheveux et on les plaçait dans le cercueil autour du défunt. Si le noir nous semble la couleur même de l’affliction par son analogie avec les ténèbres, symboles de tristesse, tous les peuples ne pensent pas de même. Les Chinois préfèrent le blanc car ils croient que les morts, en quittant notre terre, deviennent des génies bienfaisants, ou encore le bleu et le gris. Les Japonais aussi pleurent leurs morts en blanc, car pour eux, paradoxalement, le noir est symbole de la joie. En Turquie, et dans la plupart des pays musulmans, on préfère le bleu ou le violet, au Pérou et en Ethiopie le gris.
Dans l’ancienne ville d’Argos, on s’habillait de blanc pour honorer les morts et on se livrait à d’interminables festins. Les Egyptiens, eux, revêtaient des vêtements couleur feuille morte, ils couvraient leur poitrine de fleurs et leur visage de boue. Les Perses préféraient le marron. Quant à la Lycie, en Asie Mineure, on y voyait, curieusement, les hommes s’habiller en femmes pendant tout le temps du deuil. Aux Caraïbes aussi, l’accueil de la mort était assez étrange. On s’y coupait également les cheveux et on y jeûnait plusieurs jours, mais après, quand l’âme du défunt avait définitivement quitté la terre, c’était une incroyable débauche à laquelle se livrait toute la population. Les Chinois, eux, montraient davantage de dignité et… de constance. Chez eux, le deuil durait, jadis, trois ans. Et pendant tout ce temps, la vie s’arrêtait pour celui qu’un deuil affligeait. Si c’était un magistrat, il cessait d’exercer ses fonctions ; si c’était un plaideur, il suspendait ses procès. Les époux ne devaient pas avoir de commerce charnel entre eux pendant tout le deuil et les fiancés devaient attendre la fin de ces trois années d’affliction pour se marier. Les Juifs, avaient, autrefois, des manières étonnantes de porter le deuil. Ce deuil durait un an pendant lequel les enfants qui avaient perdu leur père ou leur mère devaient porter sans arrêt les vêtements qu’ils avaient le jour de leur mort, même si ces habits étaient, au bout de l’an, usés jusqu’à la corde. Par la suite, jusqu’à la fin de leur vie, les enfants devaient jeûner le jour anniversaire de cette mort. S’il s’agissait seulement d’oncles, de tantes… ou d’enfants, le deuil des juifs ne durait alors que six mois pendant lesquels ils ne se lavaient pas (!), ne se parfumaient pas, ne se coupaient pas les ongles, ne se rasaient pas et n’avaient aucun commerce charnel les uns avec les autres. Curieusement, pour un mari ou pour une femme, le deuil ne durait qu’une semaine. Mais l’époux ou l’épouse s’enfermait alors seul chez lui et, assis par terre, pieds nus, il se livrait au jeûne et aux pleurs sans discontinuer jusqu’au septième jour.
En France, les premiers chrétiens trouvaient fort déplacés toutes les marques extérieures déployées par les Juifs ou les Romains pour pleurer leurs morts, et ils enterraient eux-mêmes leurs défunts avec beaucoup de discrétion. Ce n’est qu’à la fin du Moyen Age que l’on vit réapparaître les marques extérieures du deuil, au XIVe siècle et, en particulier, dans l’entourage de la cour. Au début, les rois de France portaient le deuil en violet. C’est Louis XII qui, en 1514, introduisit la mode du noir à la mort de sa femme, la reine Anne de Bretagne. Et très vite, le deuil royal revêtit un apparat proprement démentiel. Les reines de France portaient le deuil de leur mari en robe blanche, c’est pourquoi on les appelait souvent les « dames blanches ». Mais elles devaient vivre une année entières dans une chambre entièrement tapissée de tentures noires. Tout autour d’elles, étaient drapés de noir : les meubles, les fenêtres, les objets usuels et le lit lui-même. Et même les couverts à leur table ne pouvaient être alors que d’ébène du noir le plus profond. Quand elles sortaient, après les quarante jours de claustration obligatoire, leurs carrosses aussi étaient drapés de noir, ainsi que la livrée de tous leurs serviteurs. Au XVIIe siècle, on adoucit un peu cette rigueur extrême et c’est en gris qu’Anne d’Autriche porta le deuil de son époux, Louis XIII. Elle lança, ainsi, la nouvelle mode des chambres de deuils gris perle qui fit fureur. Plus tard, c’est le violet que préféra Louis XIV pour tendre de deuil ses appartements. Ce « deuil » mobilier, comme on l’appelait, disparut pourtant peu à peu et, à la Révolution, dans les familles nobles, quand un membre de la famille mourait, on se contentait de draper de noir les antichambres, tous les sièges et le dessus de la grande porte. Napoléon 1er essaya bien de remettre en vigueur, dans sa famille, l’usage du sévère deuil de la cour. Mais sans grand succès. Le clergé, lui, n’avait vraiment jamais suivi ce déploiement de fastes lugubres. Il ne doit, en effet, porter le deuil que pour le pape et, dans ce cas, les cardinaux troquent leur pourpre pour le violet et les évêques agrémentent le violet de drap noir.
Dans l’armée, c’est au bras que les officiers portaient le crêpe de deuil et un ruban noir au pommeau de leur épée. Et dans le peuple et la bourgeoisie ? Le deuil était-il réellement suivi ? On peut dire que jusqu’à il y a à peine un siècle, ces marques funèbres furent assez scrupuleusement respectées, surtout dans nos provinces. Avec une hiérarchie très codifiée. On distinguait, ainsi, pour tous les proches (parents, enfants, époux) le grand deuil qui durait un an. Pendant six semaines, les femmes portaient un voile de grand deuil couvrant le visage et un châle de deuil sur les épaules. Pendant six mois, ensuite, elles portaient le même voile rejeté en arrière du chapeau, puis, pendant six autres mois, le voile dit « de côté », accroché en écharpe au côté du chapeau. Après cette année seulement, les veuves ou les orphelins pouvaient commencer à agrémenter leur toilette d’un peu de mauve, de gris ou de violet pendant une nouvelle année. A côté de ce grand deuil existait le demi-deuil de six mois pour les grands parents, les frères et les sœurs ou le petit deuil de trois mois pour les oncles, les tantes, les cousins et les cousines. C’est ainsi que, dans nos campagnes, on voit encore de ces pauvres vieilles qui n’ont guère quitté la robe noire depuis des dizaines d’années car, les deuils succédant aux deuils dans leur famille, elles ont fini par en faire une sorte d’uniforme.
Aujourd’hui, les marques extérieures du deuil ont pratiquement disparu. On ne voit même presque plus de crêpe au revers des vestons et des manteaux, une fois l’enterrement terminé, et toutes les maisons de coutures spécialisées dans le deuil et le demi-deuil ont fermé leur porte. Pourtant, à la campagne, subsistent encore, dans de nombreux villages, des marques curieuses du deuil. Ce sont les ruches que l’on enrubanne de crêpe noir à la mort de leur maître. Si on oubliait, en effet, de les prévenir ainsi, la tradition prétend que les abeilles pourraient en mourir… ou bien s’enfuir chez le voisin !
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Gardez l'œil ouvert et le bon si possible... + de 4 millions de visites !


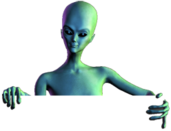





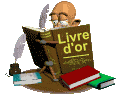

 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot












